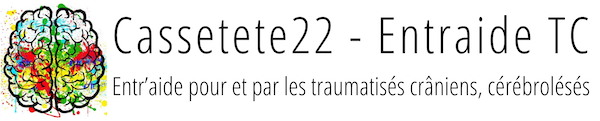Les consensus de Berlin 2016 et Amsterdam en 2022, textes de référence pour les traumas crâniens légers.
 Ces textes ont rassemblé les convergences entre chercheurs et équipes médicales qui s’intéressent aux commotions cérébrales et traumatismes crânien léger. D’où le nom de consensus, qui donne des orientations et indications partagées.
Ces textes ont rassemblé les convergences entre chercheurs et équipes médicales qui s’intéressent aux commotions cérébrales et traumatismes crânien léger. D’où le nom de consensus, qui donne des orientations et indications partagées.
La conférence d’Amsterdam en 2022 succède à celle de Berlin en 2016 ou il fut décidé de considérer que commotion cérébrale et traumatisme crânien léger étaient un seul et même « phénomène » ! Elle apporte quelques évolutions dans les recommandations quelques évolutions qui sont rapportées en fin d’article
Cela n’est pas anodin : on peut additionner les observations, et synthétiser les recommandations. Donc progresser plus rapidement.
Evidemment, cela ne coïncide pas avec large diffusion et une adoption directe dans la pratique… mais c’est une référence incontournable.
Quelques extraits du consensus sur les commotions cérébrales
Contexte d’élaboration des orientations ministérielles 2005-2010 au Québec
Solidement campées dans la perspective médicale, les orientations ministérielles 2005-2010 sont issues d’une longue tradition de traumatologie routière au Québec. La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), anciennement la Régie de l’assurance automobile du Québec (RAAQ), était en effet, depuis le début des années 90, un acteur majeur. Il était un chef de file sur le plan de l’organisation de services préhospitaliers, hospitaliers et de réadaptation à l’intention de la population victime d’accidents de la route. Dans cet esprit, les structures, les programmes et les cadres de référence établis à l’époque pour soutenir la prestation de soins et de services étaient fortement influencés par cette perspective routière et toutes les questions d’indemnisation et d’accès aux services qui l’accompagnaient. Sans surprise, les orientations ministérielles 2005-2010 se sont appuyées presque exclusivement sur le rapport du Task Force [Carroll et al., 2004; Cassidy et al., 2004; Von Holst et Cassidy, 2004] publié en 2004, un comité de travail créé par l’OMS et financé en majeure partie par l’industrie de la construction et de l’assurance automobile, dont notamment la SAAQ. Bien qu’il s’agissait certainement à l’époque du document de référence le plus exhaustif sur le sujet, il est important de reconnaître cette lunette particulière, qui nécessite possiblement aujourd’hui d’être revue dans une perspective plus élargie de traumatismes de causes variées.
La recherche de gains secondaires serait un phénomène rarissime…
McCrory et al., 2013; Harmon et al., [2013].
En ce qui concerne les facteurs liés aux questions de gains secondaires ou de compensation financière à la suite d’un TCCL/CC, seules les lignes directrices de l’ONF – version « adultes » [2013] intègrent ces éléments, en plus du fait d’avoir subi un accident d’automobile, dans la liste des éléments pouvant influencer le rythme et la qualité de la récupération. À ce chapitre, l’ONF s’est appuyé sur des lignes directrices de la Motor Accidents Authority of New South Wales [MAA/NSW, [2008] en Australie. Tout en reconnaissant que des questions de cet ordre puissent, dans certains cas, faire partie du tableau global, plusieurs auteurs, dont l’ONF [2013] et le International Initiative for Traumatic Brain Injury Research [Maas et al., 2017], soutiennent aujourd’hui que la présence de symptômes persistants résulte de l’interaction complexe, et peu comprise, entre des facteurs neuropathologiques, psychologiques et sociaux, et non principalement psychologiques comme le laissaient entendre les recommandations du Task 45 Force de l’OMS, sur lesquelles reposent les orientations ministérielles québécoises. La recherche de gains secondaires serait un phénomène rarissime et non l’unique raison pour laquelle une personne peut être amenée à amplifier ou même à générer ses symptômes [Mayer et al., 2017].
Commotions cérébrale dans le sport consensus international de Berlin- FRANCAIS
Commotions cérébrale dans le sport consensus international de Berlin- ANGLAIS
Le traumatisme crânien léger: état des connaissances
Un document Québécois de mars 2018 qui s’appuie sur le consensus de Berlin: RÉSUMÉ
Méthode
Considérant la finalité visée, la revue de la littérature a été effectuée en suivant une méthode de revue rapide et a ciblé spécifiquement les lignes directrices, les guides de pratique, les déclarations de consensus et les déclarations de position d’associations professionnelles ou d’autres sociétés savantes au Canada et ailleurs. Ces documents s’appuient sur des synthèses d’études primaires ainsi que, dans plusieurs cas, sur un processus de consensus auprès d’experts cliniques et scientifiques.
Résultats
L’analyse de la littérature met en perspective l’évolution des connaissances et des positions de plusieurs organisations au regard de plusieurs facettes du traumatisme crânio-cervical léger/Commotion Cérébrale (TCCL/CC) depuis la parution des orientations ministérielles en 2005. La dernière décennie a notamment vu apparaître un nombre important de publications et de prises de position dans le secteur plus spécifique de la CC en contexte sportif. Très influent, ce courant donne lieu à des questionnements et à certaines remises en question de la définition et de la caractérisation du TCCL, des critères de repérage et des critères diagnostiques qui en découlent.
Cette perspective favorise notamment la reconnaissance de et souvent plus subtiles, donnant lieu à un cadre de repérage, de diagnostic et d’intervention moins restrictif et généralement plus interventionniste. Ce nouveau paradigme a l’avantage, selon plusieurs, de reconnaître et de légitimer la présence de TCCL chez une certaine proportion d’individus qui se voient exclus du cadre diagnostique préconisé dans le modèle québécois actuel. S’il doit venir influencer les orientations québécoises, ce modèle pourrait toutefois avoir un effet non négligeable sur le volume de TCCL détectés ou suspectés et sur l’utilisation des ressources du réseau de la santé et des services sociaux.
Deux éléments importants dictent la prise en charge clinique à la suite d’un TCCL,
– Soit le risque, en phase aiguë, de développer des complications médicales graves en raison de lésions cérébrales actives,
– Et le risque de développer des complications fonctionnelles en phase postaiguë.
Ayant déjà fait l’objet de deux révisions officielles depuis la publication de 2005, l’algorithme décisionnel portant sur l’évaluation du risque de complications médicales graves.
Chez la clientèle adulte (version 2011), qui s’appuie sur les critères du Canadian CT Head Rule est bien appuyé par la littérature et semble donc encore très approprié dans le contexte québécois. Toutefois, il pourrait s’avérer nécessaire de réévaluer certains critères de transfert dans le réseau de traumatologie et de revoir la version de l’algorithme ciblant les enfants à la lumière de données démontrant les qualités métriques supérieures de l’outil du Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN) par rapport à celui du Canadian Assessment of Tomography for Childhood Head Injury (CATCH), sur lequel l’algorithme québécois de 2011 est basé.
Sur le plan de l’évaluation du risque de présenter des symptômes persistants
En phase postaiguë, la littérature récente met plus d’accent que les orientations ministérielles sur le fait qu’un TCCL/CC peut effectivement engendrer tout un éventail de signes et de symptômes chez un nombre significatif de personnes. L’approche visant à fournir rapidement de l’information préventive et de la rassurance demeure fortement valorisée, mais les lignes directrices et les positions plus récentes tendent à préconiser certaines interventions d’atténuation des symptômes dans une fenêtre de temps plus rapprochée de l’événement traumatique. À ce chapitre, la littérature offre différents outils et cadres d’intervention pour soutenir les cliniciens dans le processus d’évaluation et d’intervention clinique. Des lignes directrices très précises concernant les consignes de reprise des activités intellectuelles et sportives font actuellement l’objet d’initiatives soutenues de sensibilisation et de diffusion par de nombreux organismes dans les milieux éducatifs et sportifs particulièrement. Celles-ci guident présentement la mise à jour de dépliants d’information qui pourront être intégrés aux nouvelles orientations ministérielles.
Lire la suite et le document Rédigé par Catherine Truchon, Fanny Guérin, Marie-Andrée Ulysse, Geneviève Martin. Avec la collaboration de Alicia Framarin. Coordination scientifique, Catherine Truchon. Sous la direction de Michèle de Guise: Le traumatisme crânien léger INESS Québec
le site de l’INESSS au Québec Canada
Evolutions proposées par le consensus d’Amsterdam
Nous reprenons un extrait de l’article de Kathryn Schneider du 21 août 2023 du SIRC (Centre de documentation pour le sport du Canada) https://sirc.ca/fr/blogue/ommotion-cerebrale-damsterdam/
Le retour à l’exercice tôt dans le traitement de la commotion cérébrale a un effet positif sur la récupération
Les recherches récentes ont démontré que le retour à l’exercice tôt dans le traitement de la commotion cérébrale a un effet positif sur la récupération (Leddy et al., 2023).25 La déclaration de consensus d’Amsterdam recommande un Repos relatif pendant les 24 à 48 premières heures suivant la blessure seulement, y compris un temps d’écran limité. La reprise d’une activité physique légère tolérée (comme la marche) dans les 48 premières heures est recommandée s’il n’y a pas de risque de blessure. Il a été démontré que l’exercice aérobique dans les 2 à 10 jours suivant une commotion cérébrale liée au sport favorise la récupération et prévient la persistance des symptômes. Il est donc recommandé d’augmenter progressivement l’intensité de l’exercice, en fonction des niveaux de tolérance des symptômes, tant qu’il n’y a pas de risque d’impact à la tête, de collision ou de chute
De nouveaux outils ont été créés
Outil de reconnaissance des commotions cérébrales
C’est le CRT6 : Pour aider à détecter une commotion cérébrale chez les enfants, les adolescents et les adultes.
Une commotion cérébrale est une blessure au cerveau. La sixième édition de l’outil de reconnaissance des commotions cérébrales
(CRT6) est conçue pour être utilisée par des personnes sans formation médicale pour aider à la reconnaissance et la gestion immédiate
d’une possible commotion cérébrale. Le CRT6 n’est pas conçu pour diagnostiquer une commotion cérébrale.
des outils spécifiques d’évaluation :
Compte tenu des considérations relatives au développement des enfants âgés de 8 à 12 ans,
le Child SCAT6: Outil d’évaluation des commotions cérébrales dans le sport Pour les enfants âgés de 8 à 12 ans
et le SCAT6 Outil d’évaluation des commotions cérébrales dans le sport pour adolescents (13 ans) et adultes.
Il est également important de se rappeler que pour les enfants et les adolescents, le retour à l’école demeure une priorité et devrait être au centre des préoccupations des enfants et des adolescents athlètes ou sportifs. Les stratégies de retour à l’apprentissage et de retour au sport peuvent être mises en œuvre simultanément.
Les personnes de tous âges (c’est-à-dire les enfants, les adolescents et les adultes) qui présentent des symptômes continus (persistants) pendant plus de 4 semaines devraient être Référées (aiguillées) pour une évaluation plus approfondie par des cliniciens spécialisés dans les commotions cérébrales (Patricios et al., 2023a ; Yeates et al., 2023)
L’association cassetete22 Entraide TC est à votre écoute
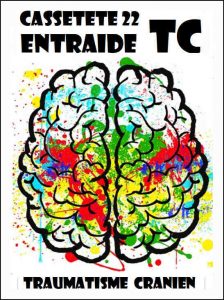
Elle offre la possibilité d’échanger avec des cérébrolésés « expérimentés » pour un partage d’expérience.
pour en savoir plus : https://www.cassetete22.com/lassociation-cassetete22-entraide-tc/
N’hésitez pas à prendre contact, nous sommes là pour vous.